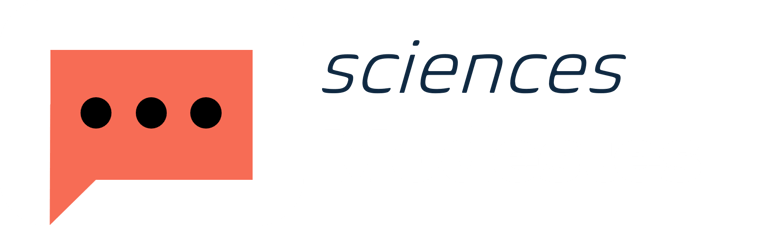La participation du public dans le champ environnemental
Le principe de la participation du public en matière environnementale figure à l’article 7 de la Charte de l'environnement et est imposés par les textes internationaux*.
En France cette participation prend plusieurs formes :
Les procédures dites «amont»: le débat public et la concertation préalable. La participation du public est préalable au dépôt de la demande d’autorisation d’un projet ou pendant la phase d’élaboration d’un plan, programme ou autre document de planification.
La procédure dites «aval» : l'enquête publique. La participation du public a lieu après le dépôt de la demande d’autorisation d’un projet ou avant la phase finale de l’approbation d’un plan ou programme.
Les procédures "amont" ont été créées suite à plusieurs conflits environnementaux, en particulier autour du « TGV Méditerranée », dans les années 90 en France conduisent à constater que l’enquête publique intervenait trop tard dans la vie d’un projet.
La participation crée un droit d'information, la possibilité de formuler des observations et des propositions et le droit d’être informé sur la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions.
S'il est souvent affirmé que la participation du public permet d'améliorer la qualité des projets, c'est principalement parce qu'en ouvrant une forme de dialogue, elle permet au porteur de projet de prendre en compte les remarques exprimées. Même s'il n'est pas toujours tenu compte de ces remarques, la procédure oblige à apporter des réponses, lesquelles peuvent favoriser une meilleure appropriation du projet.
*Principaux textes internationaux introduisant le principe de la participation du public dans le champs environnementale :
1992, le principe 10 de la déclaration de Rio indique que chaque individu doit avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision et avoir accès aux informations sur les impacts potentiels des décisions sur l'environnement. .
1998, La convention d'Aarhus. Signée en 1998 par 35 Etats et l’Union Européenne, elle est ratifiée par la France en 2002 et consacre la participation du public aux décisions prises en matière environnementale. L'article 6 de la convention précise que les délais doivent être "raisonnables pour se préparer et participer effectivement" et que la participation doit commencer dès le début de la procédure, "lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut assurer une réelle influence".
Le débat public
= Procédure créée par la loi dite Barnier de 1995 et confiée à la Commission nationale du débat public (CNDP)**. Tous les projets ne sont pas soumis à débat public mais lorsqu'il a lieur, il doit se dérouler avant que le projet ne soit engagé et dure de 4 à 6 mois.
Le bilan du débat public est établi par la commission nationale du débat public et joint au dossier de participation aval. Il n’a trait qu’au déroulement de la procédure et non au fond du projet, plan ou programme.
L'ordonnance du 3 août 2016 sur la participation prévoit qu’alternativement au débat public, une concertation avec garant désigné par la CNDP puisse être organisée. L'ordonnance crée un droit d'initiative citoyenne : 10 000 citoyens de l'UE résidant en France peuvent demander l’organisation d’un débat public ou d’une concertation avec garant pour les grands projets.
Remarque : un débat public relatif à un projet portant réforme d’une politique publique peut également être organisé au niveau national à la demande du gouvernement, ou 60 députés ou 60 sénateurs ou 50 000 citoyens de l'UE résidant en France.
**CNDP
La CNDP est créée également par la loi Barnier de 1995. Elle voit le jour en septembre 1997. le premier débat public concerne le projet Le Havre, Port 2000. La CNDP devient une autorité administrative indépendante en 2002 (elle agit au nom de l’Etat, mais ne reçoit ni ordre, ni instruction du gouvernement).
La CNDP a été saisie 516 fois en 25 ans:
Elle a organisé 104 débats publics
Elle a garanti 295 concertations
La concertation préalable
La concertation préalable figure dans le code de l'environnement depuis le 1er janvier 2017 et concerne les projets, plans, programme soumis à évaluation environnementale.
Elle peut être décidée :
par la CNDP (quand le projet relève de son champ de compétence obligatoire car supérieur à un seuil, ou lorsqu'elle a été saisie d'un projet relevant de son champs de compétence facultatif)
par l'autorité compétence pour autoriser le projet (l'entité qui délivre l'autorisation environnementale auquel le projet est soumis)
par le maitre d'ouvrage (le porteur de projet qui sollicite l'autorisation environnementale)
par le droit d'initiative***. Le public peut prendre l’initiative de demander au préfet d’organiser une concertation préalable avec garant sur un projet ou sur un document de planification.
Selon les cas, la concertation peut être organisée sous l'égide de la CNDP, avec ou sans garant de la CNDP, désigné ou non par la CNDP. Par exemple, dans le cas d'un projet relevant du champs de saisine facultative de la CNDP pour lequel la CNDP n'a pas été saisie malgré la publication de la déclaration d'intention, le maître d'ouvrage organise la concertation avec un garant de la CNDP.
L’ordonnance de 2016 prévoit aussi la création d’une liste nationale de garants de la concertation. En 2024, la liste comportait 270 noms.
Le dossier de concertation publié au moins 15 jours avant le début de la concertation, est composé des objectifs et principales caractéristiques du projet, le territoire concerné, un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement. La concertation doit d'aborder les solutions alternatives.
La durée d'une concertation préalable est comprise entre 15 jours et 3 mois.
En cas de concertation sans garant, dans un délai de 3 mois après la fin de la concertation, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable établit et publie le bilan de cette concertation.
En cas de concertation avec garant, le bilan est rédigé dans un délai d’un mois et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable dispose d'un délai de deux mois pour publier les mesures qu’il ou elle estime nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation.
Remarque : les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre du code de l'urbanisme ne sont pas soumis à la concertation au titre du code de l'environnement.
*** Le droit d’initiative
Il peut être exercé par 10 % de la population recensée dans le ou les départements/régions où se trouve tout ou partie du projet, l’organe délibérant d’une collectivité, ou une association agréée de protection de l’environnement . Il s’exerce dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la déclaration d’intention d'un projet. Le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide, dans un délai maximum d’un mois, de l’opportunité d’organiser une concertation avec garant. S’il ne se prononce pas dans ce délai d’un mois, son silence vaut rejet de la demande.
L'enquête publique
L'enquête publique concerne principalement les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et dure au minimum 30 jours. Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique au moins 15 jours avant son ouverture.
L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant (ou par une commission d’enquête si nécessaire) chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et se termine par un rapport d'enquête dans lequel il fait part de ses conclusions, favorables ou défavorables. Cet avis permet éclairer la décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet.
En cas d'autorisation accordé malgré un avis défavorable du commissaire enquêteur, la décision peut faire l'objet d'un recours contentieux. Le juge administratif pourra être saisi en référé (procédure d'urgence) pour obtenir la suspension temporaire de la décision d'autorisation.
L'ordonnance de 2016 a rendu possible une consultation par voie électronique d'une durée de 30 jours pour les projets soumis à évaluation environnementale et exemptés d’enquête publique. À la différence de l’enquête publique, il n’y a pas de commissaire enquêteur.
L'enquête publique était déjà pratiquée sous l'Ancien Régime et consistait à informer d'une décision publique d'aménagement du territoire afin que les personnes ayant des intérêts engagés, puissent se manifester.
Ce principe a été outillé et modernisé mais au fond il reste le même : lorsqu'un projet d'aménagement démarre, l'information est rendue publique sur la base d'une étude d'impact pour donner aux gens la possibilité de s'exprimer, des avis d'experts sont recueillis, un rapport est rédigé, mais ensuite peu importe les objections, le projet se réalise.
Il y a souvent malentendu sur l'objectif de la procédure. Les personnes qui se manifestent notamment au cours de l'enquête publique pensent que le projet peut être arrêté. Il n'en est rien. Il ne s'agit pas de juger de l'opportunité du projet. La procédure sert surtout à mieux faire accepter, voire légitimer, une décision prise et un projet déjà en cours de réalisation.
La procédure fait régulièrement l'objet de modernisation (Loi Bouchardeau de 1983, Grenelle 2...). Il s'agit d'une réponse classique aux aménagements sujets à conflictualités. Les oppositions qui se manifestent à l'occasion d'une enquête publique sur un projet contesté conduisent les pouvoirs publics à promettre non pas de revoir le projet en question mais la procédure d'enquête publique. L'ordonnance de 2016 sait ainsi suite au drame de Sivens (Rémi Fraisse, jeune opposant au projet de barrage du Tarn, mort le 26 octobre 2014, tué par une grenade offensive lancée par des gendarmes) qui a conduit le Président de la République François Hollande à engager en novembre 2014, un chantier sur la modernisation du dialogue environnemental.
Sources :
Site de la CNDP : https://www.debatpublic.fr/
Site du ministère de l'écologie : Le cadre de la participation du public au titre du code de l’environnement
Site du Cerema : La concertation préalable "code de l’environnement"
MOOC La participation du public dans le champ environnemental 'formation en ligne que doivent suivre les candidats à la liste des garants de la CNDP)
Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française