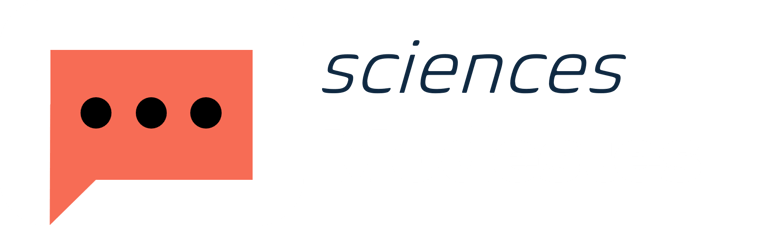L'IPBES, le GIEC de la biodiversité
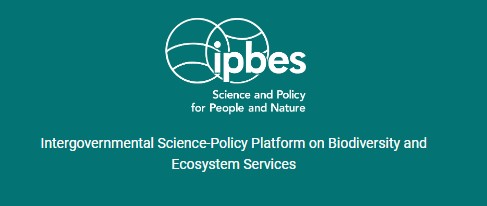

Création de l'IPBES en 2012
= Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (en français : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques).
C'est l'organisme chargé d'évaluer l’état des connaissances sur la biodiversité. A ce titre, c'est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité.
Chaque État membre des Nations unies peut y participer. En 2023, 140 États en étaient membres.
La convention sur la biodiversité a été créée au Sommet de la Terre à Rio en 1992, en même temps que la convention sur le changement climatique. Le GIEC existait avant (créé en 1988) mais il faut attendre 2012, soit 20 ans, pour la création de l’IPBES, sous l'égide du PNUE, du PNUD, de l’UNESCO et de la FAO.
L’IPBES a depuis produit une dizaine de rapports en particulier la première évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques en 2019. Il n'y avait pas eu d’évaluation de la biodiversité depuis 2005 et l'évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (Millenium Ecosystem Assessment).
Voir aussi les travaux de l'IUCN sur la biodiversité.
PNUE = Programme des Nations unies pour l'environnement
PNUD = Programme des Nations unies pour le Développement,
UNESCO = l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
FAO = l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
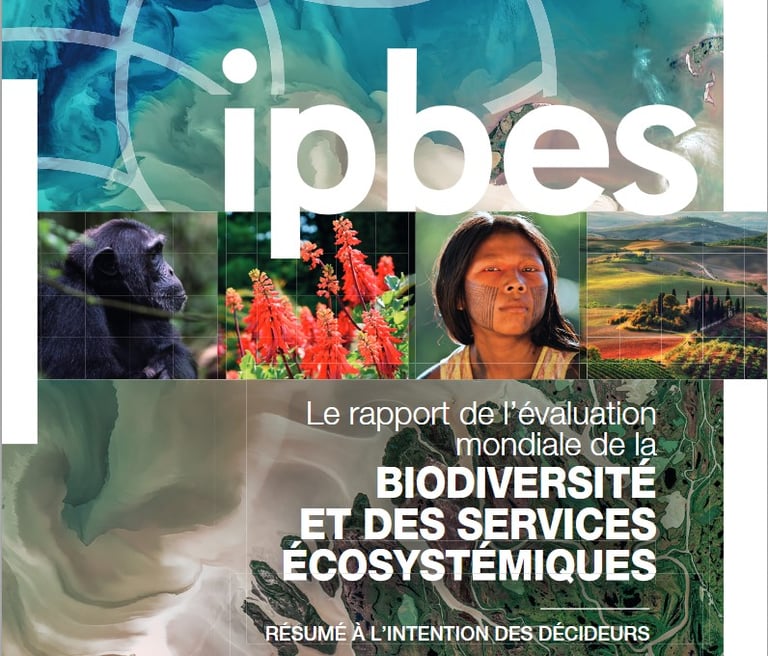
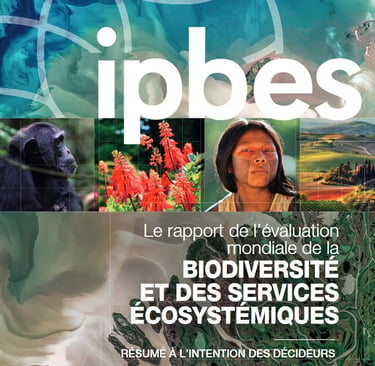
La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier »
1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction
(sur un nombre estimé de 8 millions)
En 50 ans, 70% des animaux vertébrés sauvages ont disparu.
En France, les populations d’oiseaux ont diminué de 30% les trente dernières années.
1er rapport d'évaluation de l'IPBES
Messages principaux
cf. Le résumé aux décideurs (lien vers le pdf en français).
A. La nature et ses contributions vitales aux populations, qui ensemble constituent la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques, se détériorent dans le monde entier.
B. Les facteurs directs et indirects de changement se sont intensifiés au cours des 50 dernières années. Les cinq facteurs directs qui affectent la nature et qui ont les plus forts impacts à l’échelle mondiale sont, par ordre décroissant :
(1) les changements d’usage des terres et de la mer ;
(2) l'exploitation et la capture directe de certains organismes ;
(3) le changement climatique ;
(4) la pollution et
(5) les espèces exotiques envahissantes.
C. Les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs de conservation et d’exploitation durable de la nature et de parvenir à la durabilité, et les objectifs pour 2030 et au-delà ne peuvent être réalisés que par des changements en profondeur sur les plans économique, social, politique et technologique.
D. Il est possible de conserver, de restaurer et d’utiliser la nature de manière durable et, en même temps, d’atteindre d’autres objectifs sociétaux à l’échelle mondiale en déployant de toute urgence des efforts concertés qui entraînent des changements en profondeur.
Recommandations conjointes IPBES et GIEC
Le GIEC et l’IPBES ont entamé une collaboration en 2021 pour recommander davantage de convergences entre les travaux des 2 conventions. Ils ont fait état de 3 constats :
Constat 1 : le changement climatique est la première cause de la perte de biodiversité.
L’impact du changement climatique sur la biodiversité est très documenté à la fois chez les plantes et les animaux.
Les espèces qui le peuvent migrent. Sinon on assiste à leur extinction comme le corail.
Constat 2 : il existe des solutions fondées sur la nature.
Les écosystèmes naturels absorbent environ un tiers des émissions annuelles de GES. Tout ce qui peut permettre de les protéger est bon.
La production d’aliments contribue à un 1/3 des émissions annuelles. Tout le volet transformation de l’agriculture et du système alimentaire, moins d’engrais et de pesticide, préserver et accroitre les capacités des écosystèmes. L’agriculture est une cause majeure de perte de biodiversité.
Constat 3 : certaines mesures bénéfiques pour le climat peuvent avoir des effets négatifs sur la biodiversité et les services écosystémiques
Ex : destruction des espaces naturels et des cultures vivrières pour la production de biocarburants
Ex : la plantation d’arbres à grande échelle. Elle doivent être faites sans détruire les habitats sans déplacer les populations autochtones et dans le respect des principes de l’agroécologie, au risques de développer des maladies ou espèces invasives.
Sources :
Site de l'IPBES. Communiqué de presse: Le dangereux déclin de la nature : Un taux d’extinction des espèces « sans précédent » et qui s’accélère .
Page sur le site de l'OFB. Biodiversité : changer ! agir ! Les conclusions de la première évaluation intergouvernementale.
Page sur le site de BL évolution. Le premier rapport d'évaluation mondial sur la biodiversité dévoilé !